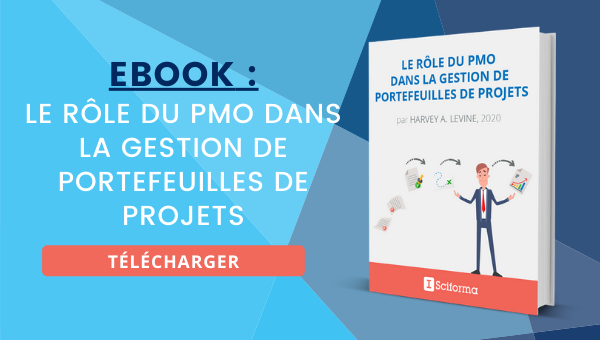Temps de lecture approximatif : 8 minutes
Les mille et un rôles du bureau de gestion de projets – PMO
En synthèse :
- Le bureau de gestion de projets est une fonction fondamentalement polyvalente, et qui tend donc à échapper aux tentatives de définition.
- Cette difficulté s’explique notamment par l’évolution significative de la mission du PMO au cours des dernières décennies, ainsi que par le nécessaire ancrage du rôle du PMO dans une organisation et un contexte spécifiques.
- Bien que les PMO d’aujourd’hui puissent jouer tout un éventail de rôles différents, on retrouve un certain nombre de constantes dans les responsabilités endossées par nombre d’entre eux, et notamment l’optimisation des méthodes, le renforcement de la collaboration et la matérialisation des orientations stratégiques.
- La nature évolutive du PMO complique encore la définition précise de son rôle — mais c’est aussi ce qui fonde toute la valeur d’un bureau de gestion de projets.
Si vous lisez ces lignes, c’est probablement que vous vous intéressez à la gestion de projets ou de portefeuilles de projets, à la transformation organisationnelle ou à la conduite du changement. Après tout, il y a peu de chances que ce soit une recherche Google du type « meilleure recette de chili végétarien » qui vous ait conduit sur cette page (si toutefois c’était le cas, n’hésitez surtout pas à contacter notre responsable référencement !)
Que vous soyez simplement intéressé par l’univers de la gestion de projets ou qu’il s’agisse de votre profession, il est normal de s’interroger sur le rôle des bureaux de gestion de projets. Les vétérans de la gestion de projets, les experts PPM et les bureaux de gestion de projets eux-mêmes ont encore du mal à s’entendre sur une définition consensuelle du bureau de gestion de projets. Peut-être parce que les PMO peuvent jouer un tel éventail de rôles divers que la fonction échappe à la caractérisation. Essayons tout de même de cerner les multiples rôles que joue le PMO.
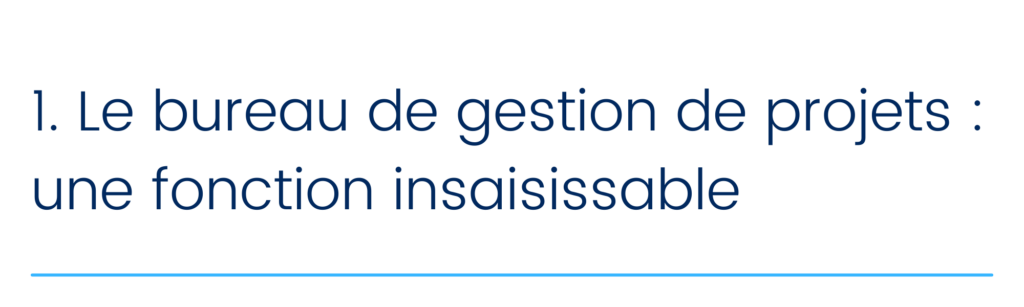
Pour le Project Management Institute, référence incontournable en matière de PPM, le bureau de gestion de projets se définit comme « une entité managériale qui standardise les méthodes de gouvernance liées aux projets et facilite le partage des ressources, des méthodologies, des outils et des techniques ».
Wikipédia fait écho à cette définition du PMO tout en la développant : « Le PMO se présente comme une partie de l’organisation qui centralise tout ou partie du pilotage et du support au management des projets, des programmes, et des portefeuilles de projets d’une entreprise. Son objectif est de faire progresser les capacités de réussite des projets par l’amélioration de leurs pilotage, des méthodes et procédures, et des ressources et compétences nécessaires. »
Pour le glossaire de Gartner, « Un bureau de gestion de projets est généralement créé pour résoudre un problème spécifique : typiquement, l’incapacité de l’organisation informatique à livrer les projets informatiques dans les délais, le budget et le périmètre impartis. » Ici, l’accent est mis sur la résolution de problèmes et l’optimisation des activités. Cette définition positionne également le PMO plus près de la sphère des technologies de l’information.
Quant aux experts Eric John Darling et Stephen Jonathan Whitty (2016), ils offrent encore une autre approche : « La forme et l’utilisation de la structure que nous appelons aujourd’hui PMO ont évolué et se sont adaptées au fil du temps. Le PMO a récemment évolué pour devenir un référentiel centralisant l’ensemble des outils et méthodologies pour ce travail non opérationnel ». En plus de souligner la position centrale et le rôle centralisateur du PMO, ils prennent ainsi acte du caractère évolutif du PMO.
Ce qui est, peut-être, la meilleure approche pour comprendre la nature, les objectifs et les rôles du bureau de gestion de projets.

Genèse et développement du bureau de gestion de projets
Avec l’essor des méthodes de gestion scientifique au début du 20e siècle, la croissance du nombre et de la complexité des projets menés par les entreprises a conduit à la création d’une fonction dédiée au suivi et à la coordination de la gestion de projets. Selon Darling & Whitty (2016), la première occurrence connue du terme de bureau de gestion de projets remonte à la fin des années 1930, suite à quoi la fonction a réellement commencé à prendre sa forme et sa portée actuelles dans les années 1950.
À l’époque, le PMO était essentiellement responsable de la réalisation des projets dans le respect des délais, du budget et du périmètre fixés. Il s’attachait donc à traiter les problématiques quotidiennes liées à la gestion opérationnelle et budgétaire des projets, en s’impliquant directement dans les opérations, et avec une approche plus administrative qu’entrepreneuriale. Les PMO étaient chargés d’injecter cohérence et reproductibilité dans la gestion des activités liées aux projets en définissant et en faisant appliquer des procédures unifiées.
Les années 1980 et l’essor de l’informatique ont donné un nouvel élan à la fonction de PMO, qui s’est imposée dans de nouveaux secteurs. La publication du premier Project Management Body of Knowledge (PMBOK) par le PMI en 1996 a contribué à installer la gestion de projets comme une discipline à part entière, renforçant ainsi le rayonnement du PMO. Les organisations de par le monde ayant compris la nécessité d’améliorer la coordination et la gestion de projets toujours plus nombreux et plus complexes, divers types de PMO ont été créés pour répondre à différents types de défis et de problèmes. Ce foisonnement de PMO localisés et ancrés dans un contexte spécifique nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui : le terme « PMO » est utilisé dans d’innombrables contextes différents et recouvre des responsabilités, des activités et des positionnements variés.
Les avatars contemporains du PMO
Dans un contexte d’incertitude de volatilité accrues sur les marchés, dans un monde marqué par de profondes évolutions sociétales, et surtout avec la révolution numérique, l’on a observé une certaine convergence dans les responsabilités assumées par les PMO – toutes zones géographiques et tous secteurs d’activité confondus.
Bien que chaque PMO reste unique, bien que la fonction reste incroyablement diversifiée, les rôles de la plupart des PMO ont évolué dans la même direction, troquant le contrôle pour la facilitation, l’exécution pour la stratégie et l’innovation, la méthode pour une flexibilité ancrée dans la donnée, l’orthodoxie budgétaire pour la création de valeur.
Les PMO « évolués » d’aujourd’hui s’attachent généralement à des problématiques de cohérence stratégique, d’optimisation des investissements, de gestion des talents, de prise de risques calculés, de soutien à l’innovation et à la collaboration, de synergies inter-organisationnelles, d’exploitation de données enrichies et d’outils intelligents, et bien plus encore.
Le PMO a donc opéré un réel saut qualitatif et a considérablement élargi ses horizons. Ce qui explique la diversité encore accrue des PMO d’aujourd’hui. Selon le secteur d’activité et la configuration de son organisation, selon les défis et les opportunités spécifiques auxquels elle est confrontée, un PMO peut avoir des objectifs très différents. Certains sont créés pour résoudre des problèmes spécifiques et remédier à des inerties ciblées. Certains ont pour mission de préparer l’entreprise à relever les défis de demain, notamment en accélérant l’innovation et la transformation numérique. D’autres ont pour raison d’être d’optimiser la valeur financière. La liste est sans fin.

Nous avons établi que, avec la diversité des bureaux de gestion de projets de par le monde, le PMO ne se prête pas volontiers à une définition univoque et exhaustive. Pourtant, la plupart des PMO partagent des responsabilités communes. En voici quelques-unes.
Suivi des activités
Bien qu’il se soit éloigné du contrôle et de la supervision pour adopter une position plus facilitatrice, le PMO reste en charge de la standardisation et du suivi des méthodes, du moins dans une certaine mesure. Les PMO élaborent généralement des systèmes de procédures et de méthodologies destinées à harmoniser la gestion des activités projets à l’échelle de l’entreprise. Ces directives communes couvrent généralement tout le cycle de vie des projets, de l’idée initiale à la livraison. Le cadre méthodologique établi par le PMO comprend également des bonnes pratiques et des indicateurs standard. Il peut être formalisé en une charte de projet officielle, partagée avec les différents services et branches de l’entreprise.
L’objectif de cet effort d’harmonisation est d’améliorer la cohérence entre les projets et de les rendre comparables. Et, en définitive, d’améliorer les résultats globaux de l’activité projets. C’est pourquoi le PMO doit également s’assurer que la méthodologie et les bonnes pratiques sont réellement appliquées. En tant que garant de la méthode, le bureau de gestion de projets supervise le cycle d’exécution pour s’assurer que les projets respectent les délais, le budget et le périmètre définis, tout en veillant à ce que les attentes des parties prenantes primaires et secondaires soient satisfaites. Cela implique de contrôler et de faire appliquer les politiques, mais aussi d’accompagner les chefs de projet et les autres catégories de collaborateurs pouvant être impliqués dans les projets. La capacité à combiner efficacement supervision et responsabilisation des équipes est de plus en plus importante à l’heure où un nombre croissant d’entreprises et d’organisations se tournent vers des méthodes de type Agile, qui mettent l’accent sur l’autonomie et la réactivité des équipes.
Gestion des données et des outils au sein du bureau de gestion de projets
À l’ère du numérique, les données sont devenues LA ressource clé pour les bureaux de gestion de projets. La capacité à recueillir et à manipuler efficacement de vastes masses de données est aujourd’hui un facteur déterminant pour la réussite d’un PMO. Par conséquent, la sélection et le déploiement de puissants outils pour exploiter les données sont d’une importance vitale pour les PMO.
Non seulement les outils contemporains de gestion de portefeuilles de projets consolident les informations relatives aux projets et automatisent les tâches répétitives, mais ce type de logiciel spécialisé offre également toute une batterie de fonctionnalités intelligentes permettant de faire parler les données. Les plateformes de gestion de portefeuilles de projets offrent des fonctionnalités de modélisation de la valeur et des risques, de simulation de scénarios, d’optimisation dynamique des portefeuilles et de l’allocation des ressources, etc. Le principal défi pour les bureaux de gestion de projets est de s’assurer que l’outil de PPM qu’ils sélectionnent et déploient est adapté aux défis et aux exigences spécifiques de l’organisation.
Car les outils de gestion de portefeuilles de projets sont comme les PMO : il n’y a pas de panacée !
Amélioration de la collaboration
Une autre des caractéristiques de l’époque actuelle est l’importance croissante de la collaboration. Les systèmes numériques connectent tout, toutes et tous à l’échelle de la planète. Les organisations capables de détecter et d’exploiter les opportunités de synergie sont celles qui remporteront la mise. Les entreprises les plus efficaces et les plus performantes font tomber les cloisons entre équipes, entre services et entre fonctions. Elles encouragent la co-construction, le partage des compétences, l’inter-fertilisation des idées ou encore les hybridations innovantes.
C’est pourquoi les bureaux de gestion de projets s’efforcent eux aussi de promouvoir les interactions et la collaboration. À cette fin, les PMO mettent en œuvre et veillent à la bonne adoption d’outils de collaboration devant permettre une communication fluide et instantanée entre les équipes, quelle que soit leur situation géographique. Ils peuvent également mettre en place des programmes de formation, d’apprentissage ou de renforcement de l’esprit d’équipe afin d’affiner les compétences relationnelles des employés. Ils peuvent encourager la diversité et l’inclusion, promouvoir une culture de la confiance et du dialogue constructif, ou encore veiller à la qualité de l’environnement de travail pour améliorer le quotidien des employés et stimuler leur créativité.
Cet effort va de pair avec le rôle d’harmonisation des méthodes et des pratiques que joue par ailleurs le PMO. Tandis que l’application de procédures communes permet de renforcer la cohésion et la cohérence de manière descendante, la diffusion d’une culture et d’une vision communes par le biais de l’intensification des interactions est une manière ascendante de resserrer les liens à l’échelle de l’organisation – tout en ouvrant la porte à la sérendipité et à l’innovation.
Gestion stratégique de portefeuilles
Les professionnels impliqués dans les activités liées aux projets doivent toujours à l’esprit l’objectif final : maximiser la valeur et les bénéfices pour l’organisation. Mais qu’est-ce que la « valeur » ? Il s’agit certes d’un concept financier, et le retour sur investissement est un aspect déterminant. Mais cette définition universelle ne tient pas compte de la dimension subjective de la valeur. Ce qui a de la valeur pour moi n’en a peut-être pas autant à vos yeux. De même, un industriel taïwanais spécialisé dans les technologies de pointe et une chaîne de restaurants du Midwest américain ne partagent pas forcément la même définition de la valeur. Ils utiliseront tous deux les mêmes indicateurs financiers (ROI, NPV, etc.), mais il est peu probable qu’ils aient les mêmes objectifs et les mêmes stratégies. Pour l’une de ces entreprises, le principal levier de croissance peut par exemple être l’expansion internationale et l’optimisation des investissements en R&D, tandis que l’autre pourrait par exemple se concentrer sur la fidélisation de la clientèle et l’amélioration de l’image de marque.
Suivant cette logique, les bureaux de gestion de projets participent activement à la réalisation de la stratégie de leur organisation en constituant des portefeuilles de projets pertinents et en les optimisant de manière stratégique. La gestion d’ensembles de projets connexes sous la forme de portefeuilles permet de gagner en efficacité. Plus important encore, cela clarifie l’objectif et la raison d’être des projets. La gestion de portefeuilles de projets rend apparents les objectifs stratégiques justifiant les projets, favorisant ainsi la cohérence et permettant de canaliser les efforts de tous grâce à une vision partagée des ambitions.
Le rôle du PMO dans la gestion et l’optimisation des portefeuilles de projets est donc essentiel. Les bureaux de gestion de projets aident à construire des portefeuilles solides et diversifiés en tenant compte des interdépendances entre les projets (par exemple les ressources partagées) et de leurs profils de risque respectifs. Ils élaborent une stratégie de sélection des projets en déployant des méthodes conçues pour aider à prioriser les projets en phase avec la stratégie. Ils suivent et optimisent également la composition des portefeuilles dans la durée afin de maximiser leurs chances d’atteindre les objectifs stratégiques.

Lorsque nous avons retracé l’évolution du PMO, nous n’avons pas mentionné une caractéristique clé des PMO contemporains : ils font constamment évoluer leur rôle et leur position dans l’organisation. Le PMO est devenu une fonction intrinsèquement évolutive, conçue pour aider les organisations à piloter le cap de leurs activités dans des conditions de marché de plus en plus instables.
Les PMO démarrent généralement sous la forme d’une petite structure et élargissent progressivement le champ de leurs activités et de leurs responsabilités. Par exemple, un PMO peut commencer en tant que bureau des projets, essentiellement chargé de superviser l’exécution. Il peut ensuite évoluer pour prendre la forme d’un PMO « sommaire » axé sur le développement de méthodologies standard et reproductibles. Puis se développer et se sophistiquer pour mettre l’accent sur la mise en place d’un environnement de travail cohésif et intégré. Enfin, il peut se transformer en un « centre d’excellence » axé sur la réalisation de la stratégie.
Mais les étapes et jalons de la maturation et de l’évolution des bureaux de gestion de projets peuvent également être moins « prévisibles » et linéaires, et impliquer des changements de direction ou des sauts qualitatifs.
Là encore, tout dépend des exigences et des opportunités spécifiques auxquelles l’organisation est confrontée et de son contexte particulier. Ce qui importe est que, pour rester pertinent et utile, un bureau de gestion de projets doit se réinventer en permanence.
Nous nous sommes ici efforcés de définir les rôles clés du PMO. Si nous avons couvert un certain nombre de sujets, nous avons laissé de côté de nombreux autres aspects de l’action du PMO, par exemple la gestion des ressources et des budget, le développement des compétences, la gestion de programmes, la sécurité des données et la conformité réglementaire, la gestion des produits… Hobbs & Aubry (2010) ont identifié pas moins de 27 fonctions distinctes pour le PMO. Une décennie plus tard, il est à parier que de nombreuses autres ont eu le temps de voir le jour. En somme, le PMO endosse tellement de rôles qu’il est condamné par la loi des probabilités à se voir décerner un Oscar !
Du point de vue d’un décideur d’entreprise, cette polyvalence du PMO a une implication importante : votre PMO peut être et faire tout ce dont vous avez besoin. Votre PMO est votre joker. Et il pourrait bien vous faire gagner la partie.